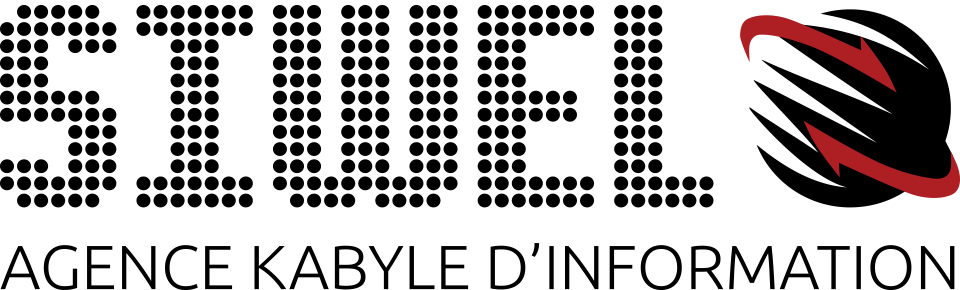(SIWEL) — En prenant toutes les précautions requises face à une terminologie et à un savoir « colonial » sur les « indigènes » dont ils occupent ou convoitent les territoires, toute étude ou document écrit du temps de la conquête de la Kabylie par la France coloniale, ou la précédant de peu, constitue une source précieuse de documentation sur la Kabylie, son organisation sociale et politique, ses mœurs et ses coutumes.
A ce titre, l’ouvrage de Patricia Lorcin, «Kabyle, arabes, français : identités coloniales» foisonne d’informations, certes extraites de publications ou de réflexions coloniales sur ce qu’elle appelle le «mythe kabyle» qui oppose le «bon kabyle» au «mauvais arabe».
Aussi, pour les kabyles dont l’existence historique en tant que peuple et nation est sciemment nié par l’Etat arabo-islamique algérien, ces documents coloniaux, quand bien même ils seraient truffés de « clichés », demeure une source précieuse d’information sur la Kabylie d’antan.
Ainsi explorant une étude très détaillée élaborée par un colon anonyme établi à Bougie dès 1836, donc avant la perte de la souveraineté kabyle, aIl s’avère que la Kabylie apparaît clairement était le territoire d’un peuple organisé, politiquement, économiquement et militairement indépendant.
Quelques extraits de faits (et non de jugements de valeurs sur les races), nous renseignent sur la Kabylie avant son annexion aux possessions coloniales françaises en Afrique du Nord, celles-ci prenant le nom de « Algérie » suite au décret colonial signé du général Shneider, le 14 octobre 1839