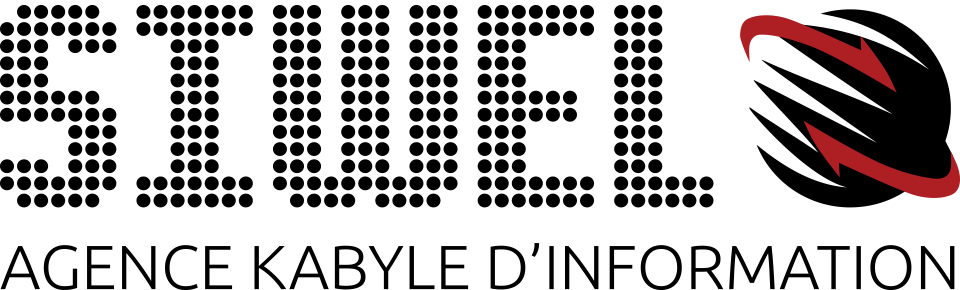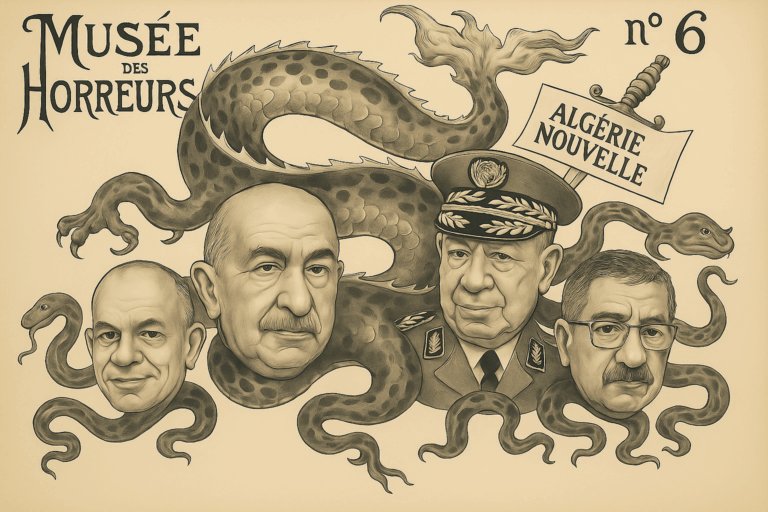Qui sont les KDS ? Réflexion sur la trahison politique et l’aliénation identitaire en contexte totalitaire

L’affaire Samir Oukaci visée par l’article 87 bis nous rappelle que les grands KDS ne désarment pas. Aussi, je vous livre cette analyse qui interroge la trahison. Ce texte est une diatribe identitaire mêlant critique politique, psychologie de la trahison, et appel à la mémoire kabyle. Il s’attache à identifier les mécanismes psychologiques, sociopolitiques et culturels de la trahison, tout en interrogeant les implications éthiques et identitaires d’un tel engagement.
Dans le contexte politique algérien contemporain, incarné par un pouvoir totalitaire et la persistance d’une idéologie nationaliste rigide, un phénomène interpelle : la participation de certaines élites politiques et intellectuelles kabyles à la perpétuation et à la légitimation de ce système. Elles nourrissent une nation fantôme qui n’a d’existence que dans l’esprit de ceux qui sont passés au génocide après un ethnocide programmé, et qui leur expriment clairement leur exclusion dans un jeu pervers d’influence, de mensonges et de soumission, par adhésion à l’idéologie officielle, par intérêts mesquins, par lâcheté ou par traitrise. Je parle bien d’un totalitarisme algérien et non d’une dictature. Selon Hannah Arendt, « le totalitarisme est avant tout un mouvement, une dynamique de destruction de la réalité et des structures sociales, plus qu’un régime fixe. Les lois deviennent toutes des lois du mouvement et la terreur constitue l’essence du gouvernement totalitaire« . Toujours selon Arendt, « la différence entre une dictature et un régime totalitaire ne se situe pas dans l’ampleur de l’arbitraire, de la répression et des crimes, mais dans le degré de contrôle du pouvoir sur la société« . Le régime algérien qui fait de l’idéologie et de la terreur son moteur d’action politique, contrôle tous les aspects de la vie en société.
Parmi ces élites au service du pouvoir, un groupe identifiable par son allégeance au pouvoir militaro-sécuritaire se détache. Ce groupe, que l’on qualifie par dérision de KDS (Kabyles de service), mérite une attention particulière tant sa posture soulève des enjeux de conscience historique, d’intégrité politique et de responsabilité morale. Il faut admettre que, le mal-être de la Kabylie d’aujourd’hui, ne saurait connaitre le bouleversement aussi profond, aussi mortifère pour ses enfants sans la complicité de ces catégories de Kabyles. C’est du moins l’hypothèse que je soutiens en me référant à ce qu’est la Kabylité fondée sur des valeurs aussi universelles qu’humaines, que sont la solidarité, la responsabilité, l’honneur, le sacre de la parole proclamée, et la dignité, matrice de toutes ces valeurs. La société de leurs ancêtres, grands-parents et même parents les aurait excommuniées. L’excommunication étant dans cette société le châtiment suprême.
Deux grandes catégories peuvent être distinguées dans cette dynamique de collaboration :
- 1. Le soutien idéologique au nom d’un nationalisme réducteur
La première catégorie regroupe ceux qui adhèrent sincèrement, naïvement, ou par confort intellectuel à l’idéologie officielle de l’État algérien, ceux-là mêmes qui s’enferment dans l’illusion d’un nationalisme restreint et dangereux, d’une unité nationale. Ils défendent une conception de la nation fondée sur une prétendue unité nationale, vidée de sa substance anthropologique et historique. Cette approche nie la diversité des peuples sous gouvernance algérienne, nie la diversité culturelle, linguistique et politique du pays. Au-delà, la diversité est vouée à disparition. De toute évidence, le peuple kabyle, millénaire violé dans sa souveraineté par la violence des armes, fait face à une politique génocidaire. Une nation véritable ne saurait se construire dans la négation de ses composantes. La refondation d’un pays ne peut se faire que sur les bases d’une reconstruction d’une humanité politique solidaire dont l’essence aurait été le respect absolu des peuples dans leur identité, de la diversité, des individus et de la nature également. Elle passe par la recherche de l’esprit critique, par le droit à la critique de toute représentation de quelque ordre qu’elle soit, par le droit à la remise en question des récits dominants. Cette reconstruction, c’est le moins que l’on puisse dire, n’est pas portée par le projet de société du pays et de l’Etat au sein duquel ces KDS s’inscrivent, par conformisme ou pare soumission. Un Etat dont la structure est dominée par une « triade noire » : le Narcissisme, la Psychopathie, le Machiavélisme, et au sein de laquelle se promulguent des lois perverses et d’un autre âge.
- 2. La trahison comme posture psycho politique
La seconde catégorie concerne ceux dont l’engagement est motivé non par conviction, mais par calcul ou par réaction émotionnelle. La trahison, dans ce cadre, n’est pas simplement une rupture politique ou idéologique ; elle est une transgression, une atteinte à un lien fondamental : celui de la confiance collective. Elle revêt un caractère éthique profond, car elle sape les fondements mêmes de la solidarité et de la reconnaissance mutuelle. D’un point de vue psychologique, ce comportement peut s’expliquer par divers facteurs : traumatismes non résolus, faible estime de soi, peur du déclassement ou du rejet, besoin de reconnaissance symbolique, ou encore désir de domination. Dans bien des cas, la trahison fonctionne comme un mécanisme de défense identitaire : pour éviter la marginalisation ou maintenir une position sociale, certains choisissent d’adhérer à l’ordre dominant, quitte à renier leurs origines ou les aspirations de leur communauté. Cette forme de trahison peut également s’inscrire dans une logique de « soumission volontaire », selon laquelle l’individu préfère intégrer les normes imposées par le pouvoir plutôt que de s’y opposer. Cela traduit une forme d’aliénation profonde, dans laquelle la recherche de reconnaissance se fait au prix de la dignité collective.
Réflexion identitaire : rupture avec l’imaginaire kabyle
L’analyse des figures de la collaboration au sein du système algérien permet de mieux comprendre les logiques de pouvoir, de soumission et de trahison qui traversent la société. Elle invite aussi à repenser les conditions d’une véritable refondation politique qui passe par une éthique de la reconnaissance et du respect profond de l’altérité. Dans ce cadre, l’Histoire devrait rendre justice au peuple Kabyle afin qu’il renaisse à la souveraineté entière, à la prise en main de sa propre destinée.
Quant à l’Algérie et aux Algériens pourraient-ils seulement, et devraient-ils se soustraire à la vision totalitaire de l’Etat pour revendiquer et considérer une autre conception de la nation ! Non pas comme une entité figée et uniforme, mais comme un espace en perpétuelle construction, reposant sur l’Histoire, l’appartenance, la reconnaissance de la pluralité et de la diversité ! Dans ma vision politique, la question kabyle a, depuis la naissance de l’Algérie post française, constitué un axe de confrontation politique majeure, un frein à un développement sociopolitique positif du pays. Aussi, l’indépendance de la Kabylie devrait être soutenue par les Algériens, leurs élites, afin de rompre avec une vision trouble du monde et rebâtir un pays nouveau avec un projet de société nourri par la liberté.
Raveh Urahmun, exil, le 6 novembre 2025
********
Quelques ouvrages utiles pour comprendre le totalitarisme et la trahison :
1. Sur la trahison politique et morale
- Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre. Éditions du Seuil, 1990 : Réflexion philosophique sur l’identité, la responsabilité et la mémoire. Utile pour penser la trahison comme rupture éthique.
- Camus, Albert. L’Homme révolté. Gallimard, 1951 : Camus analyse la trahison de la révolte initiale par certains intellectuels. Résonne fortement avec la dénonciation des élites collaboratrices.
- Grossman, Vasili. Vie et destin. L’Âge d’homme, 1983 : Roman sur la trahison dans un régime totalitaire. Utile pour faire des parallèles entre collaboration, peur et perte de dignité.
2. Sur les régimes autoritaires et la psychologie du pouvoir
- Arendt, Hannah. Les origines du totalitarisme. Éditions Gallimard, 1972 : Une œuvre fondamentale pour comprendre comment les régimes autoritaires utilisent l’idéologie et l’atomisation sociale.
- Freud, Sigmund. Psychologie des foules et analyse du moi. Payot, 1921 : Pour comprendre la soumission volontaire et l’identification au chef.
- Lipovetsky, Gilles. Le crépuscule du devoir. Gallimard, 1992 : Analyse la montée de l’individualisme narcissique dans les sociétés modernes.
Sur la nation et les formes de domination :
- Anderson, Benedict. L’Imaginaire national. La Découverte, 1996 : Théorie du nationalisme comme construction imaginaire. Essentiel pour déconstruire l’« unité nationale » imposée.
- Bourdieu, Pierre. La domination masculine. Seuil, 1998 : Pour comprendre les mécanismes de reproduction sociale et symbolique de la domination, transposables au politique.