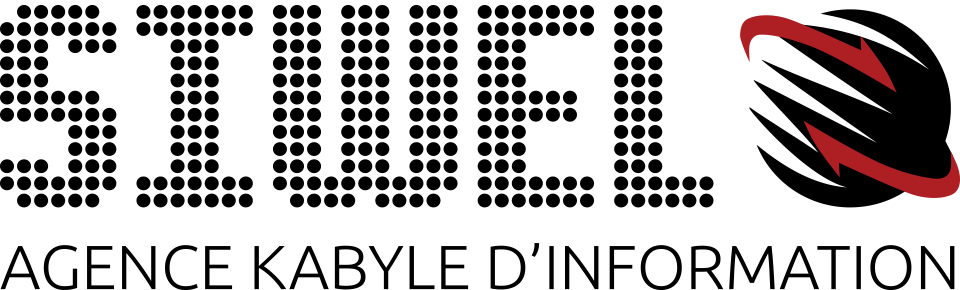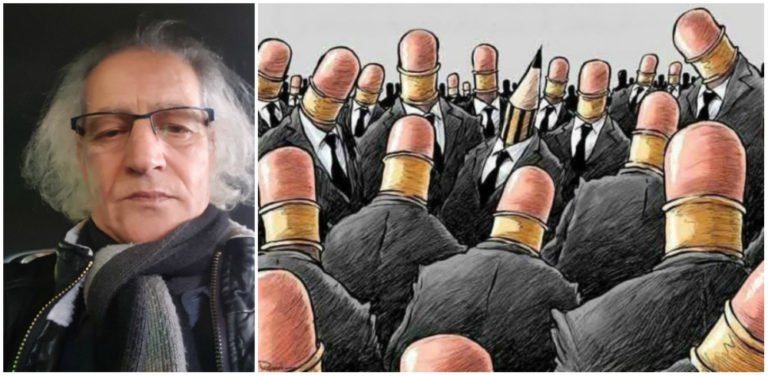Les noces manquées de la littérature et du peuple

CHRONIQUE (SIWEL) — Riche d’une année passée au Québec, j’étais retourné en Algérie pour la première fois en 2013. Sur le plan de la culture littéraire, j’avais plus appris durant cette courte année que durant toute une vie en Algérie.
Plus j’apprenais et plus je prenais conscience de la rumeur sombre et froide qui émanait du néant qu’était mon ignorance. Celle-ci s’affirmait au fur et à mesure que j’ouvrais un bouquin. C’est ainsi que de fil en aiguille, cette rumeur, aussi sombre et aussi épaisse qu’une nuit sans étoiles, se transformait en une douce angoisse qui ne s’estompait que durant les instants furtifs qui suivaient la fin d’une lecture quelconque.
J’avais alors droit à un semblant de trêve, mélancolique, qui me berçait dans mes songes. Cette douceur n’était, à mon grand désarroi, que preste. Elle s’estompait aussitôt que ma curiosité m’eût fait part d’un autre livre ; d’un autre monde encore vierge qui n’attendait que moi pour être découvert.
Malgré tout, je n’étais qu’à moitié à l’aise lorsque j’abordais ce thème avec mes ami.e.s. Bien que je fus capable de citer Hugo, Céline, Proust et bien d’autres en chœur, j’étais incapable de placer le moindre mot sur n’importe quel-le auteur-e de chez nous.
Il faut dire qu’une seule partie de notre culture nous a été transmise : celle qui nous a été inculquée par la poésie, les proverbes et les chants. Et ceux-ci ne comprenaient pas les écrits de Djaout, Djebar, Kateb et les autres, puisque nos grands-parents étaient pour la plupart illettrés.
La seule approche que l’on ait fait de la culture, des années durant, à l’école algérienne, fut à travers le cours de science islamique. Il ne s’agit pas, ici, de critiquer l’Islam en tant que tel ou de remettre en question sa légitimité comme approche spirituelle.
Je condamne son instrumentalisation, prise comme moyen univoque et exclusif présenté aux étudiant.e.s afin d’aborder des thèmes aussi cruciaux et aussi fondamentaux que ceux de la culture, de la spiritualité, ainsi que de l’identité.
Lorsque Hugo disait que »Le meilleur moyen de fermer des prisons était d’ouvrir une école » il n’avait sans doute pas préfiguré l’instrumentalisation qu’allait subir celle-ci à des fins aussi sombres qu’absurdes.
Le malaise décrit plus haut se transformait en une honte ostentatoire lorsque l’un.e de mes ami.e.s, français.e, québécois.e, ou de toute autres origines me demandait des conseils afin d’aborder, de la meilleure façon qui soit, la littérature de mon pays d’origine. Mes réponses furent tantôt une délicate esquive, tantôt un silence.
Si ce dernier était assourdissant pour mon esprit, il était orageux pour mon cœur.
C’est dans ce chambardement que s’articula une question qui me tortura jusqu’à très récemment : ma honte était-elle légitime ?
L’on pourrait alors douter des compétences des enseignant.e.s qui forment ces étudiant.es en les privant, pour ainsi dire, d’être eux-mêmes. Peut-être même qu’il faudrait douter de la pertinence des formations données dans les universités algériennes à ces mêmes enseignant-e-s ?
Chemin faisant, pour faire court, peut-être qu’en ce qui concerne la littérature, les professeur.e.s ne font que garder jalousement ce trésor de savoir et de culture au peuple ? Ce qui est fort regrettable. Ce que l’on devrait aussi leur reprocher, c’est d’avoir cloisonné cette culture littéraire autour des cercles universitaires, exclusivement. Ceci a eu pour effet d’élever au rang de »mythe » la culture de la lecture. Cette mystification a eu pour répercussion de déposséder le peuple d’un bien qui lui revient pourtant totalement de droit : son identité.
Un problème de diffusion
Faisons maintenant abstraction du problème de l’école. À mon arrivée en Algérie, je me dirigeai vers la première librairie que je croisais sur mon chemin – celui-ci a été long, rappelons qu’il n’y a que 40 librairies en Algérie. Mes yeux pétillaient ; je tenais à peine sur mes genoux lorsque j’y suis entré. J’avais passé les deux derniers mois à lire et à scruter les œuvres qu’il fallait lire – c’est-à-dire à peu près tout.
J’avais un sac à dos vide afin de pouvoir le bourrer de mes trouvailles. Je voulais assouvir cette soif incommensurable de lectures et de découvertes. J’étais cet aventurier qui, se sentant sur le point de faire une découverte majeure, peinait à respirer, le temps lui-même s’étant figé autour de lui au même instant que se cristallisait sous ses yeux ce dont il n’osait même pas espérer ; ne sachant plus si c’était l’éclat de son désir qui embrumait sa vue ou bien les larmes que faisait couler son émotion sur ses paupières.
Pour moi, ce que j’allais trouver là n’était rien d’autre que la partie qui me manquait afin de cerner mon identité la plus profonde, celle dont je puisais ma force pour affronter le monde depuis tant d’années, en ne l’ayant qu’entrevue à travers la bouche de nos grand-mères et les chants de nos poètes, et qui de loin en loin, surgissait des profondeurs de mes angoisses.
Tout s’évanouît dès l’instant où je rentrais dans cette librairie. Le naïf qui y était entré était sorti désillusionné ; désabusé. Le prix moyen des bouquins était, au minimum, trois fois plus cher qu’au Québec. Je n’en revenais pas.
De 700 à 1300 Da en moyenne le bouquin ! Lorsque je travaillais comme manœuvre, je gagnais 800 Da par jour. En faisant le calcul, c’est comme si un livre coûtait 120 $ dans une librairie québécoise. Je les achète à 2$ l’unité; 20 à 30$ pour les plus dispendieux. Cela donne une idée de cette inaccessibilité.
Néanmoins, j’étais sorti de cette rare librairie avec trois bouquins, non sans un pincement au cœur, car je savais que je n’aurais jamais pu acheter un seul livre si j’étais venu à cette librairie lorsque je vivais en Kabylie.
C’est en faisant cet amer constat que je suis arrivé à répondre à ma question : Oui, ma honte était légitime. Cependant, la paix était venue à moi lorsque je décidais que ce n’était pas de ma faute si j’étais aussi peu au courant de mon propre héritage culturel, mais celle d’un système malade qui ne demande qu’à être évincé.
La culture littéraire est censée appartenir au peuple tout entier et non à une élite – qu’elle soit bourgeoise ou intellectuelle. Un peuple sans littérature est un peuple sans culture ; un peuple sans culture est un peuple sans identité ; un peuple sans identité ne fait qu’airer dans la pénombre, sans jamais entrevoir la moindre lumière. L’on ne pourrait dire que ce peuple existe, puisqu’il ne fait qu’effleurer sa propre existence.
Il faut remettre au peuple son dû. C’est seulement lorsqu’il saura qu’il sera.
Akli Ait ElDjoudi
SIWEL 200955 Aug 17 UTC