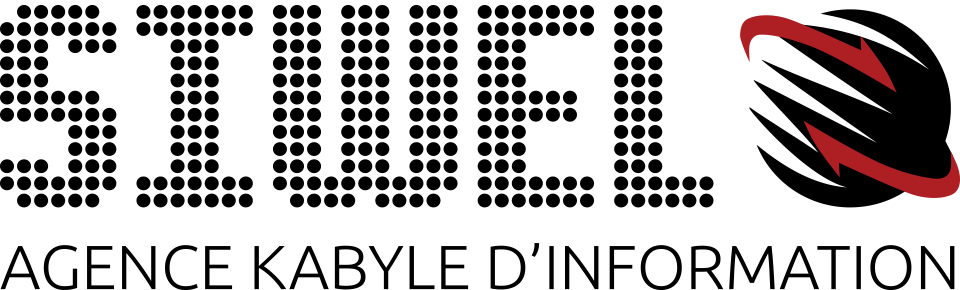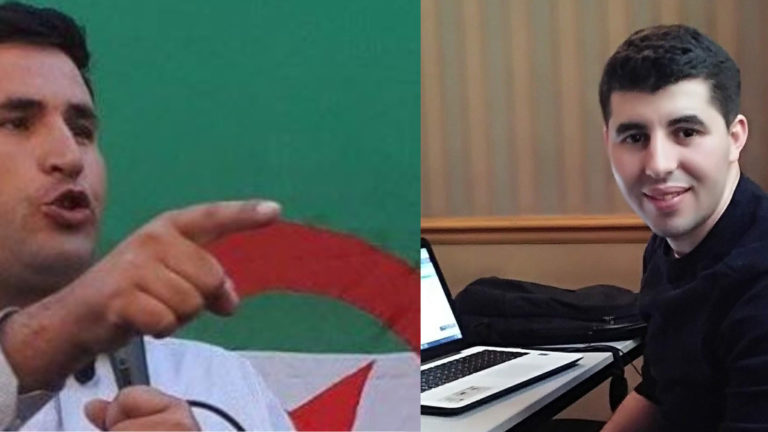Le véritable naufrage : quand ceux d’hier accusent ceux qui relèvent la Kabylie

Le naufrage des consciences avant celui des causes
Il est des reniements plus amers que les défaites, des silences plus meurtriers que les trahisons.
Celui qui, aujourd’hui, s’érige en procureur du « naufrage » du mouvement indépendantiste kabyle ferait bien de sonder sa propre mémoire : car nul ne peut prétendre défendre la Kabylie lorsqu’il a, par son mutisme ou ses compromissions, contribué à l’affaiblir.
Le déclin d’un peuple ne naît pas des rêves de liberté, mais du renoncement à ces rêves. Il se nourrit de la peur, de la résignation, du mépris de soi et des siens. Le seul naufrage véritable est celui des consciences : lorsque ceux qui se veulent gardiens de la morale préfèrent condamner les artisans de la liberté plutôt que les fossoyeurs de la dignité.
Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) n’est pas la cause de la dérive : il en est le sursaut, la respiration d’un peuple que l’histoire a trop longtemps maintenu à genoux. Le MAK, c’est le cri d’une nation étouffée, l’effort de redressement d’une Kabylie qu’on voulait croire épuisée, mais qui retrouve, dans l’épreuve, la force de se tenir debout.
L’indispensable rigueur du débat kabyle
La Kabylie traverse un moment charnière de son histoire, une heure où les débats politiques devraient être des espaces de lumière et non des champs d’ombre.
Le désaccord est légitime ; la disqualification ne l’est pas.
L’auteur de la tribune intitulée « Kabylie : le sursaut ou le naufrage » a choisi le glaive plutôt que la plume, la dénonciation plutôt que l’argument. Nous lui répondons non dans le tumulte des passions, mais dans la clarté de la raison et le calme de la responsabilité.
Car l’indépendantisme kabyle ne relève ni du délire ni de la démagogie : il s’enracine dans une pensée politique, mûrie par la douleur et portée par la mémoire. Il s’appuie sur le droit et la légitimité morale d’un peuple en quête de reconnaissance.
La dérive polémique et la confusion morale
Qualifier un mouvement politique de « délinquance », d’« imposture » ou de « secte », c’est substituer l’invective à la pensée. C’est choisir la blessure du mot plutôt que la rigueur de l’idée.
Ces vocables ne sont pas des arguments, mais des pierres jetées dans le puits du dialogue.
Une telle écriture, si elle cherche à émouvoir, échoue à convaincre : elle confond la force de la conviction avec le fracas de l’insulte. Elle brouille les frontières entre la critique légitime et l’animosité personnelle, entre le désaccord politique et la mise au ban morale.
Ainsi, prétendre défendre Taqbaylit et Tagmatt tout en usant du mépris et de la disqualification, c’est ruiner les fondements mêmes de ces valeurs. La dignité kabyle ne se nourrit pas d’invectives ; elle s’élève dans le respect du débat.
La contradiction n’est pas une menace : elle est l’essence même de la liberté.
Des présupposés idéologiques fragiles
1. Confondre désaccord politique et menace pour la Kabylie
L’auteur de la tribune fait du MAK la source de tous les maux, la cause première de la prétendue « dégradation morale » de la société kabyle, allant jusqu’à affirmer qu’il « fournit du carburant à la répression ».
Mais cette lecture inverse le sens de l’histoire : le pouvoir algérien ne réprime pas parce que la Kabylie se perd, il réprime parce qu’elle résiste.
Le MAK n’est pas un facteur de désordre, mais une réponse à l’ordre imposé, une réaction à des décennies de négation linguistique, culturelle et économique.
Accuser la résistance d’alimenter la répression, c’est blâmer l’oiseau pour le vent qui le gifle, le prisonnier pour les barreaux qui l’enferment.
2. Dénaturer le projet indépendantiste
Qualifier le MAK de « secte » revient à insulter l’intelligence de milliers de militantes et de militants qui, à travers le monde, défendent pacifiquement et publiquement le droit d’un peuple à disposer de lui-même.
Le MAK n’exige pas d’allégeance mystique : il réclame un engagement lucide.
Sa doctrine politique s’enracine dans le droit international, dans les articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies, qui consacrent le droit des peuples non souverains à l’autodétermination.
Ses structures sont transparentes, ses débats ouverts, ses orientations publiques.
Réduire cette organisation à une dérive sectaire, c’est nier la tradition intellectuelle millénaire de la Kabylie : celle de la fierté et de la liberté, de la raison et de la dignité.
3. Confondre excès individuels et ligne politique
Tout mouvement humain charrie ses imperfections, ses failles, ses débordements.
Les généraliser pour condamner tout un projet relève de la malhonnêteté intellectuelle.
Le MAK ne prêche ni la haine ni la violence verbale ; il prône la fermeté de l’idée, la clarté du verbe, la rigueur du débat.
Transformer des incidents isolés en essence politique, c’est substituer l’anecdote à l’analyse, l’écume à la mer.
La légitimité du projet kabyle : droit, raison et éthique
1. Le fondement juridique
L’indépendantisme kabyle n’est ni un caprice ni une chimère. Il découle du droit inaliénable des peuples à l’autodétermination.
La Kabylie, par sa langue, son histoire, sa culture et sa conscience de soi, répond à toutes les exigences du droit international public.
Réclamer pacifiquement un référendum, c’est exercer un droit, non défier une loi. Confondre cette exigence avec une déviance, c’est nier le droit même d’exister politiquement.
2. Une nécessité historique
De la répression du Printemps noir de 2001 aux arrestations de militants pacifiques, l’État algérien n’a offert à la Kabylie que la contrainte du silence.
Dans ce désert de reconnaissance, l’idée d’indépendance n’est pas une fuite : elle est un refuge.
Elle représente la voie rationnelle et pacifique pour garantir la survie culturelle et démocratique d’un peuple que l’histoire n’a cessé d’éprouver.
Le MAK ne prêche pas la rupture par ressentiment, mais par responsabilité : pour rendre à la Kabylie la souveraineté qu’on lui refuse et la dignité qu’on lui doit.
3. Une éthique de la dignité
L’engagement indépendantiste n’est pas nourri par la haine, mais par la volonté d’exister debout.
Il ne divise pas : il réveille.
Tagmatt véritable n’est pas celle du silence soumis, mais celle du courage solidaire.
Se taire devant l’injustice, c’est pactiser avec elle ; parler, c’est rompre ses chaînes.
Pour un débat kabyle apaisé et adulte
La Kabylie ne se relèvera pas dans le tumulte des invectives.
Elle grandira dans la clarté des échanges et la noblesse du désaccord.
Nous appelons à un débat argumenté, apaisé, où chaque courant politique puisse défendre sa vision sans être voué aux gémonies.
Le MAK accepte la critique — pourvu qu’elle s’élève de la raison et non qu’elle s’abaisse dans la haine.
Le véritable sursaut que réclame la Kabylie naîtra du dialogue entre ses forces vives, de la réconciliation entre ses intelligences, et de la fidélité à la vérité.
Du naufrage moral au sursaut des peuples libres
Il est aisé de brandir le mot « naufrage » pour condamner ceux qui osent rêver.
Mais le naufrage n’est pas celui du MAK : il est celui des consciences qui ont abdiqué, de ceux qui ont préféré la posture à la lucidité, la parole facile à l’action courageuse.
Le prétendu “sursaut” qu’on nous oppose n’a rien d’un élan vital : c’est le dernier soubresaut d’un discours essoufflé, celui d’une conscience qui tremble de peur à l’idée que la Kabylie se relève sans son autorisation.
Ceux qui, hier, ont servi le système qu’ils fustigent aujourd’hui portent la part la plus lourde de ce naufrage.
Car on ne redresse pas un peuple en le culpabilisant ; on l’élève en l’appelant à la dignité.
La Kabylie, elle, n’a pas sombré
Elle se relève, portée par la génération du refus et du courage.
Et si naufrage il y a, ce n’est pas celui du mouvement indépendantiste, mais celui de ceux qui ont trahi la possibilité d’un avenir libre.
Le sursaut, lui, est déjà en marche — dans chaque conscience qui choisit la lumière du combat à l’ombre de la résignation.
Ḥasan At Aɛmaṛ Waɛli
Novembre 2025