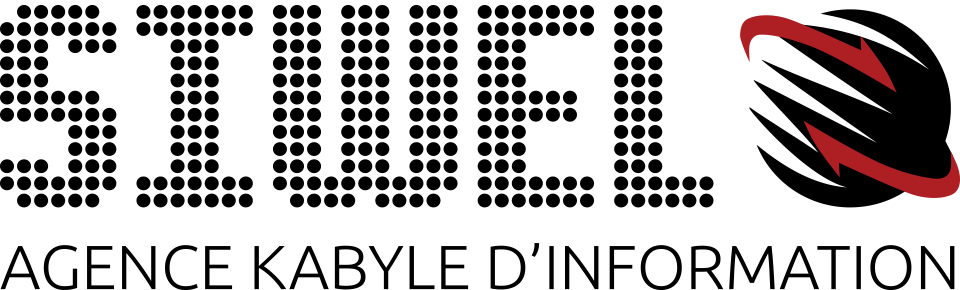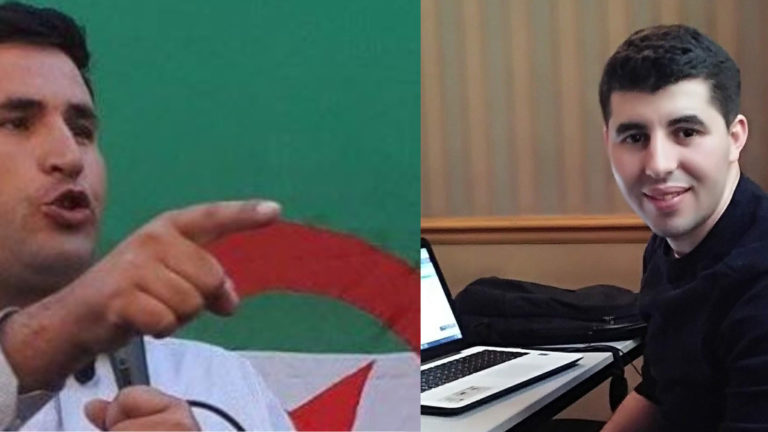Devoir de justice et témoignage pour l’Histoire : la résistance du peuple kabyle

Canada (SIWEL) —Il est de notre impérieux devoir de consigner pour la postérité la condition du peuple kabyle, nation antique et fière, rivée depuis des millénaires à ses montagnes telles des « sentinelles de l’histoire ». Ce peuple, dont la noblesse se mesure à l’aune de la richesse de sa culture, à la profondeur de ses traditions et à la dignité inébranlable de ses enfants, est en proie à une tragique contradiction depuis l’avènement de l’Algérie indépendante en 1962.
Alors que le pays s’émancipait du joug colonial, une nouvelle aliénation, plus subtile mais non moins réelle, s’est instituée. La Kabylie, pourtant héroïque dans la lutte pour l’indépendance, s’est vue niée dans son être même. La constitution algérienne, en érigeant l’État-nation sur le dogme d’une « Algérie arabe et musulmane », a sciemment occis les langues de Tamazight, et notamment la langue kabyle, cette âme immémoriale de la Kabylie.
Cet acte fondateur ne fut point une simple omission ; il s’agissait d’une négation politique, une tentative d’effacement systématique d’une identité plurimillénaire. Comme le soulignait l’écrivain Albert Camus, « sans culture, et la liberté relative qu’elle suppose, la société, même parfaite, n’est qu’une jungle. C’est pourquoi toute création authentique est un don à l’avenir. » En reléguant le peuple kabyle et les autres peuples autochtones au rang de parias sur leur propre terre, le pouvoir algérien a cultivé cette jungle de l’oubli.
Face à ce déni constitutionnel, un long et douloureux processus d’assimilation forcée s’est déployé. L’arabisation à outrance, la marginalisation économique, la répression culturelle et la diabolisation de toute revendication identitaire sont devenus les instruments d’un pouvoir jacobin. Pourtant, contre vents et marées, la Kabylie n’a jamais fléchi. Son peuple a opposé une résistance pacifique mais inflexible, une lutte organisée qui a traversé les décennies, incarnant cette maxime de La Boétie : « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. »
Le prix de cette résistance fut exorbitant, payé en vies humaines et en larmes. Le Printemps berbère de 1980, le Printemps noir de 2001 – avec son cortège de 128 martyrs – et des décennies de manifestations souvent réprimées dans le sang, sont autant de stigmates et de preuves indélébiles de son combat pour la reconnaissance et la liberté. Chaque victime est un témoin silencieux de l’acharnement d’un système et de la ténacité d’un peuple. Elles rappellent, à l’instar de Victor Hugo, que « les conquêtes de la force sont fragiles, les conquêtes de l’idée sont éternelles. »
Aujourd’hui, l’évidence s’impose : la lutte porte ses fruits. Les sacrifices n’ont pas été vains. Les pressions constantes, la résistance culturelle et les mobilisations de masse ont arraché des concessions significatives. La reconnaissance tardive de Tamazight comme langue nationale en 2002, puis officielle en 2016, sont des victoires historiques, malgré leur conditionnement. Chaque école qui enseigne la langue, chaque media qui la diffuse, est une brèche dans le mur du déni, une semence pour l’avenir.
L’Histoire, enregistrant à la fois l’injustice et la résistance, rendra son verdict final. Elle retiendra que le peuple kabyle, sur sa terre ancestrale, a été contraint de mener une seconde lutte pour sa libération, non plus contre un colonisateur étranger, mais contre un centralisme négateur. Un colonialisme intérieur. Son parcours est un testament universel pour la défense des droits des peuples autochtones, un écho à la pensée de Rousseau sur le contrat social bafoué. Son combat, loin d’être terminé, se poursuit pour une pleine égalité des droits et une indépendance réelle qui garantisse sa pérennité. Car, comme le proclamait Aimé Césaire, « il est place pour tous au rendez-vous de la conquête.
Vive la Kabylie libre et indépendante.
Bualem Afir.