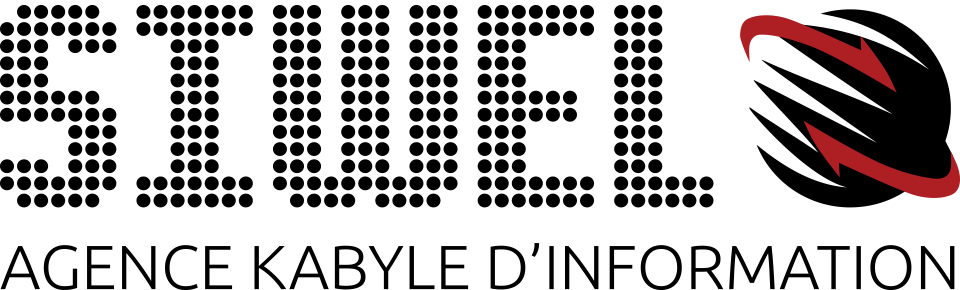Quand l’allié historique brise le tabou : Moscou questionne la légitimité des frontières algériennes

EDITO (SIWEL) – Dans une déclaration qui a pris de court la diplomatie algérienne, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a publiquement remis en question la légitimité des frontières héritées de la période coloniale en Afrique du Nord. Lors d’une intervention récente, le chef de la diplomatie russe a explicitement évoqué la question du peuple touareg, pointant du doigt les conséquences du découpage colonial qui a « morcelé des peuples entiers et créé des tensions persistantes ».
Les propos qui dérangent
« Les frontières tracées par les colonisateurs européens ont artificiellement divisé des populations qui partageaient une histoire, une culture et un territoire communs », a déclaré Lavrov, ajoutant que « ces lignes arbitraires continuent de nourrir l’instabilité dans plusieurs régions d’Afrique ». En citant nommément les Touaregs comme exemple de peuple fragmenté par ces frontières coloniales, le diplomate russe a touché à un sujet que le régime algérien considère comme intouchable.
Ces déclarations marquent une rupture dans le discours traditionnel de Moscou vis-à-vis d’Alger. Jamais auparavant un responsable russe de ce niveau n’avait publiquement questionné la configuration territoriale de l’Algérie, encore moins évoqué l’existence de peuples distincts sur son territoire. Pour un régime obsédé par le dogme de l’« unité nationale » et de l’« intégrité territoriale », ces propos constituent un camouflet diplomatique majeur.
L’isolement diplomatique du régime algérien
Cette sortie publique de Lavrov intervient dans un contexte d’isolement croissant du régime algérien. Sur la scène régionale comme internationale, Alger multiplie les échecs.
En Afrique du Nord, la rupture avec le Maroc a atteint un point de non-retour. La fermeture du gazoduc Maghreb-Europe et la rupture des relations diplomatiques ont isolé Alger sur le plan économique et stratégique, l’enfermant dans une posture de confrontation stérile.
Au Sahel, l’influence algérienne s’est effondrée. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont rapprochés d’autres partenaires, notamment la Russie elle-même, marginalisant totalement la diplomatie algérienne. Les tentatives d’Alger de s’imposer comme acteur majeur dans la résolution des crises sahéliennes ont toutes échoué.
Sur le plan international, l’Algérie peine à trouver sa place. Ses positions ambiguës lors de conflits majeurs et sa diplomatie erratique l’ont progressivement marginalisée. Même au sein des instances africaines, le poids diplomatique d’Alger ne cesse de décliner.
Quand Moscou recalcule ses intérêts
La prise de position russe est d’autant plus significative qu’elle provient d’un pays considéré comme l’un des derniers soutiens d’Alger. Pendant des décennies, Moscou a été le principal fournisseur d’armes du régime algérien, son partenaire énergétique et son allié diplomatique.
En remettant publiquement en cause les fondements territoriaux de l’État algérien, la Russie envoie un message sans équivoque : elle ne se considère plus liée par la complaisance diplomatique du passé. Moscou diversifie ses partenaires régionaux et n’hésite plus à dialoguer avec tous les acteurs, y compris ceux qu’Alger considère comme hostiles. Le régime algérien n’a plus de véritables alliés, seulement des partenaires opportunistes qui réévaluent leurs relations en fonction de leurs propres intérêts.
Un État qui ne répond à aucun critère de Nation
Au-delà des jeux diplomatiques, les propos de Lavrov mettent en lumière une réalité que le régime algérien s’acharne à dissimuler : l’Algérie ne répond à aucun des critères définitoires d’une Nation. Elle est un assemblage artificiel de peuples distincts, aux histoires, aux langues et aux cultures propres, maintenus ensemble par la force et la négation systématique de leurs identités.
Les Touaregs, explicitement cités par le diplomate russe, incarnent cette réalité. Leur territoire ancestral a été fragmenté par des frontières coloniales que le régime algérien a sacralisées. Leur langue, leur culture et leurs modes de vie ont été systématiquement marginalisés par une politique centralisatrice qui refuse toute forme de diversité.
Mais les Touaregs ne sont pas les seuls. Le peuple kabyle subit depuis 1962 une répression continue pour avoir refusé l’uniformisation forcée imposée par le pouvoir central. L’arabisation obligatoire, la négation de la langue Kabyle, la militarisation permanente de la Kabylie, les massacres lors des soulèvements populaires, le Printemps berbère de 1980, le Printemps noir de 2001, témoignent d’une violence institutionnelle assumée. Chaque génération de Kabyles a connu la répression, l’emprisonnement des militants, l’interdiction des partis politiques, le verrouillage sécuritaire de leur région.
Les Mozabites, les Chaouis, les populations du Sud ont été soumis à la même logique : effacer leur spécificité, nier leur histoire, imposer une identité unique définie par le pouvoir central.
La répression comme seule politique
Face aux revendications légitimes des peuples qu’il prétend gouverner, le régime algérien n’a jamais proposé d’autre réponse que la répression. En Kabylie, cette répression prend des formes multiples : contrôles militaires permanents, arrestations arbitraires de militants, interdiction des rassemblements, censure des médias indépendants, harcèlement judiciaire. Le pouvoir central refuse obstinément toute forme de décentralisation, tout statut particulier, toute reconnaissance officielle de la langue et de la culture kabyles. ainsi que le droit légitime du peuple kabyle à l’autodétermination.
Cette politique génère une instabilité chronique. Loin de consolider l’unité qu’il prétend défendre, le régime creuse chaque jour les fossés qui séparent les peuples du pouvoir central. L’absence totale de légitimité démocratique, le verrouillage de tout espace politique achèvent de délégitimer un système à bout de souffle.
Le droit des peuples contre l’héritage colonial
La déclaration de Lavrov, aussi opportuniste soit-elle, rappelle une vérité historique : les frontières coloniales n’ont aucune légitimité au regard du droit des peuples à l’autodétermination. Ce principe, inscrit dans la Charte des Nations Unies, affirme que chaque peuple a le droit de déterminer librement son statut politique.
Or, l’État algérien repose précisément sur la négation de ce principe. Les peuples qui composent son territoire n’ont jamais été consultés sur leur appartenance à cet ensemble artificiel. Les frontières qui les enferment sont le pur produit d’un découpage colonial que le pouvoir militaire algérien a choisi de perpétuer pour maintenir son emprise.
Les peuples niés ne renoncent pas. Ils transmettent leur mémoire, préservent leur langue, résistent à l’assimilation forcée. L’histoire enseigne qu’aucun État fondé sur le déni ne peut se maintenir indéfiniment par la seule contrainte.
Ulysse