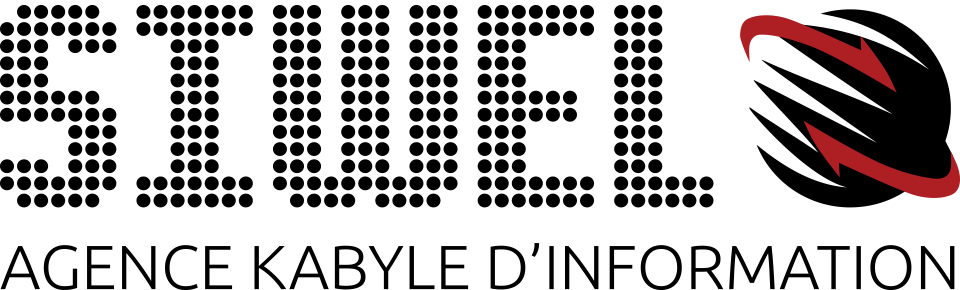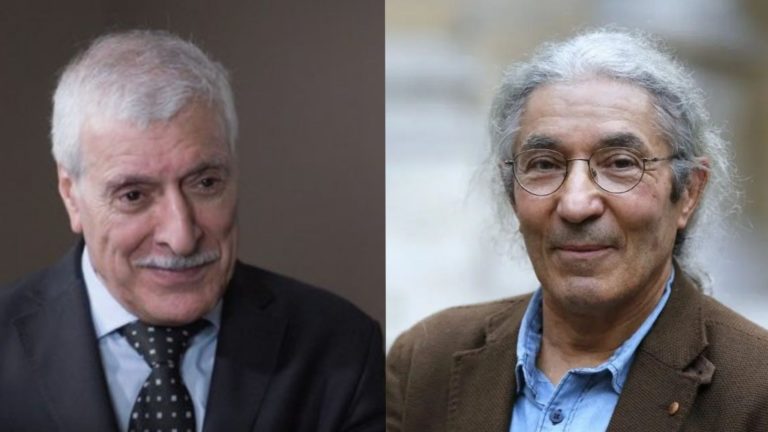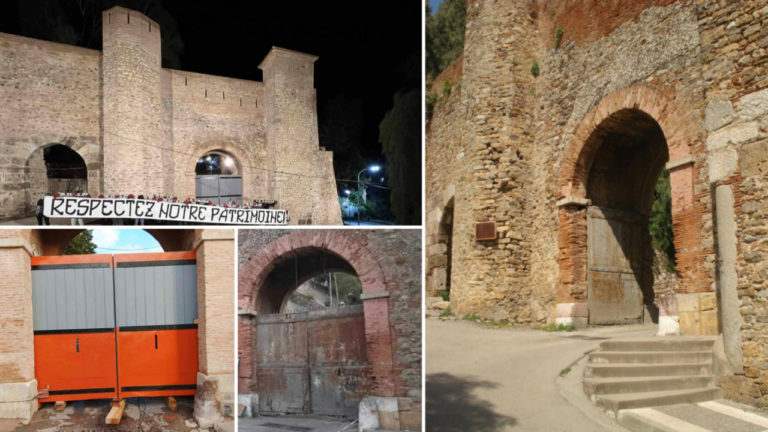VIDEO – Kabylie : la grandeur d’un pays ne se mesure pas à sa taille
Résumé de l’interview accordée par le Dr Arezki Dahmani, économiste et consultant en développement en Afrique et en méditerranée, autour de sa vision économique d’une future Kabylie indépendante, ainsi que de ses prérequis politiques et sociétaux.
Tilelli : Le projet de Constitution de l’Anavad évoque un système fédéral pour la Kabylie. Êtes-vous en phase avec cette approche ?
Arezki Dahmani : Oui, pleinement. Le fédéralisme est un modèle de gouvernance adapté à tous les territoires, car il rapproche le pouvoir des citoyens. Les États modernes comme les États-Unis, la Russie ou l’Australie l’ont adopté avec succès. En Algérie, le centralisme a été un échec : il a étouffé la démocratie, l’économie et les libertés locales. Quoi ce n’est plus notre affaire.
Pour la Kabylie, un système fédéral serait naturel, car les Kabyles sont par tradition des citoyens de proximité, autonomes, gestionnaires et profondément démocrates.
Je vois une Kabylie fédérale structurée autour de cinq États : Tizi Ouzou, Tuvirett (Bouira), Vgayet, Jijel et Boumerdès. Chacun aurait une fonction spécifique :
- Tizi Ouzou, capitale politique ;
- Béjaïa, capitale économique et culturelle ;
- Bouira, capitale académique et de formation ;
- Boumerdès, capitale scientifique et technologique ;
- Jijel, capitale touristique.
Le pouvoir ne doit surtout pas être centralisé dans une seule ville, car cela irait à l’encontre de l’esprit même du fédéralisme. Chaque région doit développer ses propres atouts pour former, à terme, ce que j’appelle les “États-Unis de Kabylie”.
Certains estiment que la Kabylie est trop petite pour un modèle fédéral de type “États-Unis”. Qu’en pensez-vous ?
La grandeur d’un pays ne se mesure pas à sa taille, mais à l’intelligence de son peuple. La Suisse, Israël ou le Japon sont petits par la superficie, mais grands par leur excellence. La Kabylie, forte de sa diaspora et de sa civilisation millénaire, possède tous les fondements pour réussir : une mémoire historique, une culture solide et un esprit d’innovation.
Quelles seraient les bases économiques d’une Kabylie indépendante ?
La première richesse, ce sont les ressources humaines — à la fois en Kabylie et dans la diaspora, estimée à près de huit millions de personnes réparties dans le monde. Si cette diaspora mobilise son savoir-faire, aucune aide extérieure ne sera nécessaire.
Ensuite, il faut investir dans les infrastructures : routes, ports, aéroports, rail, énergie et eau. Ces quatre piliers — ressources humaines, infrastructures, énergie et eau — forment la base du développement durable et de l’attractivité pour les investisseurs.
Comment financer de telles infrastructures ?
Si la Kabylie se dote d’un État de droit, d’une démocratie réelle et d’un environnement ouvert et tolérant, les investisseurs étrangers viendront naturellement.
La Kabylie devra se présenter comme une terre d’accueil, où toutes les croyances sont respectées : « Juifs, chrétiens, musulmans, athées — tout le monde est bienvenu ».
Sur chaque port kabyle, il faudra inscrire une devise simple : Bienvenue, avec ta foi ou ton absence de foi.
Quels principes sociétaux devraient guider la future Kabylie justement ?
La première valeur, c’est l’égalité totale entre les femmes et les hommes, notamment dans l’héritage et les droits civiques. La deuxième, c’est la laïcité, fondée sur la liberté de croire ou de ne pas croire.
L’éducation devra être repensée : il faut sortir l’arabe du système scolaire, car il n’apporte rien au développement. À la place, la Kabylie devra promouvoir le kabyle, le français, l’anglais et l’espagnol, pour ouvrir sa jeunesse au monde.
L’école doit être le moteur du progrès. Inspirons-nous du modèle allemand : la formation par alternance, dès le collège, pour allier savoir et pratique. L’objectif est que chaque jeune trouve sa place dans l’économie, sans chômage massif.
Le plus grand chantier sera celui de la décolonisation mentale. Il faudra déconstruire 63 ans de propagande, de mensonges et de révisionnisme historique. La Kabylie devra regarder son histoire en face, sans haine ni revanche, mais avec lucidité.
Ce travail de mémoire est essentiel pour bâtir un État solide sur des fondations claires.
Enfin, pour les KDS, qui est également un sujet de société, il n’y aura pas de vengeance ni de camps de redressement. Mais chacun devra assumer ses choix. Et un État de droit doit rester ferme dans ses relations : la démocratie n’est pas la faiblesse. Avec les démocrates, nous parlerons démocratie ; avec les tyrans, nous parlerons leur langage.
Un mot de conclusion ?
Ce rêve ne peut se réaliser seul. Il faudra l’énergie, la conviction et la participation de tous les Kabyles, d’ici et d’ailleurs. Ce sera un chantier immense, mais avec la volonté, la foi et la solidarité, le possible deviendra réalité.
nbb,